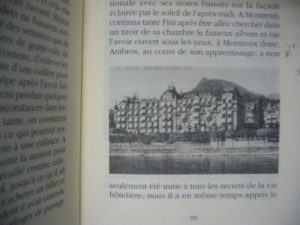Actes & Volumes collectifs
ARTICLE
De la carte postale, il peut sembler difficile mais surtout presque illégitime de chercher à suivre à la trace les migrations : non seulement la question des migrations se pose mais la question même du genre n’est pas réglée. La carte postale n’est peut-être au mieux qu’un cas particulier du « genre » épistolaire, si celui-ci existe, ou une « forme » dédiée à un usage spécifique.
La difficulté de ces questions tient d’abord au cadre limité d’une recherche en cours, qui ne serait pas à même de saisir l’ampleur de ces migrations. Mais elle tient aussi à des raisons intrinsèques à cet objet qu’est la carte postale.
D’une part, parce qu’il s’agit d’un objet anodin du quotidien, quoique largement passé de mode, et tout entier associé à son usage communicationnel, quoique largement dépassé, il est presque trop présent pour que ses migrations soient visibles. Cet outil de communication connut de fait un développement extrêmement rapide à partir de son adoption à peu près concomitante dans les années 1860 par les postes américaines et, à partir d’une première expérience de l’empire austro-hongrois, par toutes les postes européennes. Ce fut une sorte de révolution des communications que cette carte – de format standard, à la correspondance « découverte » (contrairement aux plis sous enveloppe) sur une face réservée et à un prix moindre que la lettre – qui profita d’une certaine uniformisation des tarifs internationaux dans le cadre de l’Union Postale Universelle en 1874 [1] . Elle connut une diffusion rapide dans le temps donc et une expansion dans l’espace à la faveur d’une circulation transnationale voire internationale, dans un monde d’abord largement dominé par les empires coloniaux puis par la mondialisation des échanges. La carte postale pourrait ne s’inscrire que dans des déplacements et tracer la carte (sans jeu de mots) des migrations, qu’elles soient touristiques, politiques ou économiques.
D’autre part, parce que la carte est précisément d’abord un support, c’est-à-dire cela même que la littérature cherche à faire oublier – ou à sublimer – quand elle promeut des formes et des genres, sa légitimité comme forme artistique est d’emblée problématique. La question artistique concerne les cartes elles-mêmes, surtout à partir du moment où les cartes ont été illustrées, convoquant différents artistes, des photographes aux graphistes et aux mail artists, qui travaillent ce support spécifique. Mais cette question concerne aussi le cadre énonciatif qu’elles semblent mettre en place, s’érigeant en forme musicale ou poétique ; il faut sans doute, pour choisir d’exploiter les contraintes et l’imaginaire liées à cet objet, des profils particuliers cités ici pour mémoire, dans le domaine français : Apollinaire, poète épistolier s’il en est ; Henri Jean-Marie Levet, poète diplomate si cela existe ; Paul-Jean Toulet, poète voyageur qui s’écrit à lui-même ; Perec, poète de l’infra-ordinaire...
Les exemples qui vont nous intéresser dans cette analyse permettent peut-être d’aborder la question autrement : ils relèvent du domaine moins exploré de la fiction narrative de la fin des années 1960 au début des années 1990. Nous nous appuierons en effet notamment sur le roman de Claude Simon, Histoire (1967) [2] et sur le « récit », pour reprendre la catégorie générique proposée par le sous-titre lui-même, de W. G. Sebald, « Ambros Adelwarth » tiré de Die Ausgewanderten (1992) [3] .
Le rôle central de l’image dans tout l’œuvre de Simon est connu et celui de Sebald se caractérise en outre par l’insertion de reproductions. Prendre le biais spécifique de la carte postale, c’est engager à nouveaux frais cette réflexion sur l’image, travaillée par l’investissement littéraire des enjeux de la communication. Aussi faudrait-il mentionner l’ouvrage de Derrida La Carte postale, de Socrate à Freud et au-dela [4] ; mais il ne s’agit ni d’un essai sur la carte postale ni d’un exemple d’application : cet article ne saurait s’en prévaloir mais il n’en est pas moins essentiel dans notre recherche.
Nous interrogerons la façon trois fois paradoxale dont les cartes postales impliquent pour les personnages des fictions un rapport à l’espace et au temps que l’on pourrait dire « immédiat », pour les narrateurs une expérience de « l’épaisseur » et pour le lecteur une possibilité de fiction « éthique ».
Migration et communication : l’immédiateté de la carte postale ?
La carte postale pourrait sembler obéir à un impératif ou à un désir de communication et permettre d’établir un contact, malgré la distance (elle serait structurellement faite pour cela) et les délais (quant à eux conjoncturels et toujours promis, par l’efficacité des services postaux, à se réduire...).
Histoire ne commence pas par la découverte de cartes postales qui guideraient ou feraient l’histoire mais la première d’entre elles apparaît dès la première séquence de ce long roman, qui en compte douze, non numérotées et de longueurs variables. Les cartes interviennent juste après l’incipit, dans lequel l’acacia de la maison familiale, si présent chez Claude Simon joue le premier rôle et où s’est mise en place « l’assemblée des ombres » [5] .
Le flot du texte est continu depuis le haut de la page seize, où l’on comprend que le narrateur parle de sa mère (« le visage de maman » [6] ) et de son père déjà décédé, sur plus de quatre pages. Voici la fin de la séquence qui nous intéresse, avec une coupe :
[...] elle pouvait voir ornant les timbres de ces cartes postales qu’il lui envoyait ne portant le plus souvent au verso dans la partie réservée à la correspondance qu’une simple signature au-dessous d’un nom de ville et d’une date par exemple :
« Colombo 7/ 7/ 08
Henri »
Et au recto (quand elle – la jeune fille qu’elle avait été – avait lu le nom de la ville la date la signature et qu’elle retournait la carte, elle et grand-mère assises l’une en face de l’autre devant leurs minuscules tasses de ce chocolat à l’espagnole qui leur détraquait le foie [...])... au recto donc, un port, le palais d’un gouverneur, la salle à manger d’un paquebot, le lac argenté scintillant d’obscurs palmiers aux troncs couchés sur l’eau une pirogue, avec, comme légende, Fishing by Moonlight on the Colombo Lake » [7]
De part et d’autre de la parenthèse sont données d’une part, « au verso », la citation du texte de la carte postale, certes plus que lapidaire et, d’autre part « au recto », la mention tout aussi succincte du sujet qui, pour une même date et pour un même lieu pourrait être interchangeable : un port ou le palais d’un gouverneur ou la salle à manger d’un paquebot ou le lac argenté... qui correspond à la légende figurant en anglais sur cette carte représentant le lac de Colombo, dans l’ancienne Ceylan.
Il y a aurait là, sous la forme anodine, technique et commerciale d’un moyen de communication postal, une possibilité de conjurer l’éloignement dans l’espace et l’écoulement même du temps. On pourrait dire que pour les acteurs de son réseau de communication, celui qui envoie et celui qui reçoit, la carte postale fait coexister dans l’espace deux temporalités, comme elle ferait aussi coexister dans le temps deux espaces correspondant à l’écriture et à la lecture ou plus largement à la préparation de l’écriture et sa réception...
En outre, le récit mime les étapes de la réception passée, où la correspondance serait lue, malgré son peu d’intérêt, avant que l’image ne soit vue alors même que cette vue est associée au « recto » : dans ce retournement de la réception de la carte se joue pourtant moins une hiérarchie entre le texte et l’image qu’une réversibilité entre ces deux faces.
Dans le récit de Sebald, la première carte est celle qui montre le premier hôtel, qui est à la fois la première étape de la migration d’Ambros, parti d’Allemagne et son premier lieu de travail.
In Montreux, fuhr die Tante Fini fort, nachdem sie das Album aus einer ihrer Schlafzimmerschubladen hervorgeholt und vor mir aufgeschlagen hatte, ist der Ambros...
A Montreux, poursuivit Tante Fini, après avoir rapporté l’album de l’un des tiroirs de sa chambre et l’avoir ouvert devant moi, Ambros a non seulement été [8] ...
Ce que porte la carte postale est un « Je suis ici » doublé de la représentation du lieu. Comportant texte et image, elle serait à même de les faire coïncider : le scripteur écrit « sur » l’endroit où il est et le donne à voir « directement », « immédiatement », c’est-à-dire dans l’illusion de l’immédiateté, et malgré la rétrospection et le changement énonciatif (« In Montreux [...] ist der Ambros... »). Le « Je suis ici » tautologique de la carte n’est pas un procédé d’illusion comme celui que Roland Barthes assigne au cinéma par opposition à la photographie : « le cinéma ne serait pas de la photographie animée : en lui l’avoir-été-là disparaîtrait au profit de l’être-là de la chose » [9] . Avec la carte, l’être-là engage un « je » qui ne se donne pour présent, au mieux, que sous la forme d’un fétiche de peu, éphémère, interchangeable et à peine personnalisé. Ajoutons que cette image industrielle et touristique adopte un point de vue idéal, quelque chose comme le regard de Dieu, sur la Riviera – fût-elle celle du lac Léman – depuis le lac lui-même.
Le paradoxe, c’est que le texte et l’image apparaissent comme l’émanation personnelle de celui qui envoie la carte, alors même que l’image est standardisée et industrielle autant que le texte est répétitif et contraint. L’établissement d’un contact ne va donc pas sans une complexification de la communication, saisie dans un objet littéraire sur lequel il nous faudra revenir.
Pour les personnages de nos fictions, les cartes constituent un ensemble ou disons plutôt qu’elles ont constitué progressivement un ensemble, une collection : leur achat/leur rédaction ou leur réception/lecture sont des événements autonomes mais des deux côtés de cette communication, elles s’inscrivent dans une série. Celle des cartes envoyées successivement qui sont autant d’étapes d’un voyage. Celle des cartes conservées : la carte de Montreux est la première carte des lieux de villégiatures dans lesquels Ambros va séjourner, d’abord comme employé des hôtels eux-mêmes puis comme employé, accompagnateur ou compagnon du richissime Cosmo Solomon : le « Paradeissos in Alexandria » cité juste avant la carte de « L’oasis d’Héliopolis. Casino », le « Banff Springs Hotel » des Rocheuses canadiennes avec une carte, l’ancien « Grand hôtel des Roches noires » de Deauville, le Normandy dans la même station balnéaire [10] .
Cependant, la première carte est conservée par Ambros lui-même et non adressée à sa famille pour témoigner de cette première étape : si elle fait partie d’un ensemble, c’est de l’album de l’oncle Adelwarth, dont la tante Fini a hérité (Ansichtkartenalbum : littéralement un album de cartes de « vues » [11] ). Ansichten peut d’ailleurs désigner ce type de cartes postales : on le retrouve à propos des « vues » du voyage égyptien, dont le texte nous donne trois exemples alors qu’une seule reproduction apparaît, celle d’un kafeneion d’Alexandrie [12] . La collection est destinée au scripteur lui-même, comme une sorte de journal cartophilique.
Dans Histoire, les cartes fonctionnent par paquets : on rencontre ainsi un ensemble de cartes qui ne sont ni écrites ni postées et « vendues en bloc » [13] mais les paquets les plus importants sont bien entendu ceux conservés dans un tiroir par la mère du héros, longuement évoquées « pêle-mêle » dès la première séquence. On les voit ressurgir dans la séquence huit au moment de vider la commode que le narrateur doit vendre [14] ; le troisième tiroir donne lieu à un véritable catalogue [15] .
Elles s’accompagnent alors d’un rappel subreptice de la figure de la mère, comme figée dans une glace de cette même maison de famille, « relisant encore une fois le laconique libellé d’une des innombrables cartes postales Singapore Colombo Diego-Suarez Haïphong ou en écrivant elle-même trempant sa plume dans cette encre violette qui en séchant prenait des reflets vert mordoré »... D’ailleurs la mère se confond avec ce meuble de souvenirs et son contenu : elle est ce « sac postal », ce « sac de peau enfermant non plus les organes habituels foie estomac poumons et cætera mais rien d’autre que de la pâte à papier sous forme de vieilles cartes postales et de vieilles lettres nouées en paquets » [16] , elle est carte postale.
On peut tirer deux conclusions partielles de ce traitement des cartes par les personnages.
D’une part, les cartes semblent ambitionner par leur multiplicité une véritable saisie dynamique du monde. Dans ces ensembles toutes les cartes, et de loin, ne sont pas citées ni même mentionnées autrement que dans un décompte, souvent imprécis d’ailleurs, au bénéfice d’un effet de masse rétrospectif comme dans le cas du tiroir rempli dont nous venons de parler : « comme des cartes à jouer dans le sabot d’un croupier » [17] mais aussi comme des fiches de bibliothèques qui sont autant de « fantômes » des livres eux-mêmes.
Les lieux auxquels renvoient les cartes sont pourtant loin de constituer le fil linéaire des voyages des personnages, même pour eux-mêmes, du fait des aléas de leur conservation et de leur classement. Si la lecture autobiographique de l’œuvre de Claude Simon situerait à Salses la « maison dans le sud » dont il est question au moment des transactions chez le notaire, et expliquerait la récurrence des références à Madagascar, le texte d’Histoire fait éclater l’empire colonial français, de Madagascar au Tonkin, nous fait aller jusqu’à Ceylan et aux Seychelles [18] , en passant par Lourdes et par Limoges...
Mais cette hétérogénéité n’en est pas moins érigée en saisie du monde, à l’image du monde même précisément. Dans Histoire, dès la première occurrence, cette idée s’impose à travers autant d’avatars de la carte :
[...] fragments, écailles arrachées à la surface de la vaste terre : lucarnes rectangulaires où s’encadraient tour à tour des tempêtes figées, de luxuriantes végétations, des déserts...
Ce kaléidoscope, puisque le paradigme des images projetées comme autant de vues est sous-jacent, n’est donc pas pour autant une mise en ordre, au contraire : par elles, le monde fait « irruption » (p. 20)
D’autre part, cette tendance à la collection et plus largement à la conservation compense le caractère éphémère des cartes : elles peuvent être conservées au bénéfice de qui les a reçues, susceptible de les relire/revoir et de rejouer le récit... mais ce faisant elles sont aussi disponibles pour une destination seconde.
La carte postale peut-elle cependant être différente de tout écrit migrateur, c’est-à-dire inscrit dans l’espace et dans le temps comme les lettres, et peut-être aussi de tout écrit autobiographique soumis à un lecteur ? Toute la singularité du Je, du présent et de l’ici propres au discours devrait, dans l’expérience de la lecture, rencontrer le Je du lecteur, dans le temps de sa lecture et dans son lieu, pour produire un plaisir du texte (et de l’image... mais où l’image serait subordonnée au texte et donc ne serait qu’un autre texte).
En s’intéressant à la narration, on pourrait observer un autre investissement, plus spécifique, de la carte postale.
Migration et narration : l’épaisseur des cartes postales ?
Ces ensembles de cartes dont nous venons de parler sont loin de la structure de ce que l’on pourrait appeler pleinement un « récit par cartes » comparable aux romans par lettres et qu’illustre, au moins en partie, Postcards, un roman d’Annie Proulx [19] contemporain des récits de Sebald. De fait nos fictions mettent en scène dès le début un narrateur pour qui les cartes deviennent, rétrospectivement et alors qu’elles ne lui étaient pas destinées, vrai matériau.
Elles sont d’abord quasiment le vecteur d’une mémoire involontaire.
C’est particulièrement net dans Histoire, où le texte bifurque sans cesse, au plan temporel mais également énonciatif, à la faveur d’un détail qui peut faire passer d’une époque à une autre, d’une expérience à une autre, voire d’un énonciateur à un autre.
Cet effet productif de la carte pour le personnage-narrateur dans le roman serait à l’aune de son fonctionnement pour l’auteur du roman lui-même. Claude Simon, dans un entretien contemporain de la publication d’Histoire revenait ainsi sur la genèse de son œuvre :
J’avais trouvé un stock de cartes postales, où je reconnaissais une correspondance de mon père fiancé avec ma mère. Je savais depuis longtemps l’existence de ces cartes, et tout à coup j’ai eu envie de les décrire, de les raconter. J’ai publié une quinzaine de pages là-dessus dans Tel Quel, au cours de l’hiver 1964. J’ai repris ce petit texte avec l’intention de le développer un peu et il est devenu ce roman de quatre cents pages » (Claude Simon, « Le roman se fait, je le fais, et il se fait », entretien avec Josiane Duranteau, Les Lettres françaises, 13-18 avril 1967).
Cet entretien est également cité dans une notice sur « Les cartes postales d’Histoire » du site de l’Association des Lecteurs de Claude Simon, qui quantifie par ailleurs la « collection d’environ 360 cartes conservées par la mère de Claude Simon » :
http://associationclaudesimon.org/claude-simon/iconographie/article/les-cartes-postales-d-histoire
Nous reviendrons sur les reproductions de ces cartes elles-mêmes mais il est d’ores et déjà frappant de constater la reconstitution génétique voire archéologique par laquelle le matériau, qui n’est pas visible directement dans le texte, est mis au jour. Alors que l’on est capable d’explorer les glissements par rapport à l’autobiographie, qui sont avérés pour les lieux ou les personnages (« Henri » par exemple n’est pas exactement Louis Simon...), on semble avoir beaucoup plus de mal à prendre ses distances avec ces images perçues comme des documents.
Pour autant, les récits pris en charge par les narrateurs à partir de ces documents ne les utilisent toujours comme tels.
Dans le texte de Sebald, à propos de la carte postale de l’hôtel de Montreux, le narrateur cite sa propre tante juste avant le passage que nous lisions pour commencer : « Il me semble en tout cas que c’était l’Eden, dit tante Fini… » [« Ich glaube jedenfalls, sagte Tante Fini, dass es das Eden war... »] [20] Pourtant au regard de la vie du personnage, cet Eden n’a constitué au mieux qu’une étape, avec laquelle contrasteront la suite et la fin. Mais il s’agit aussi d’un décalage entre le récepteur passé des cartes et le narrateur qui les utilise. La tante Fini est cette narratrice seconde, dans le récit du narrateur dont Ambros Adelwarth est le « grand oncle » ; elle-même « émigrante », elle opère clairement une lecture édénique a posteriori de la vie de celui qui a réussi, dont l’oncle puis le médecin donneront plus loin au narrateur une autre vision.
Sebald l’indique avec une économie et une distance apparente. C’est en effet le personnage d’Ambros, le grand-oncle auquel le narrateur semble laisser la main pour finir, qui écrit lui-même dans son « petit agenda » [Agendabüchlein] [21] , qui est aussi une « sorte de journal » [eine Art von Tagebuch] [22] ), la « dernière notation » et même plus exactement le « post-scriptum » ; il s’agit pourtant d’une remarque sur le souvenir, qui pourrait aussi être celle du narrateur voire de l’écrivain lui-même :
Le souvenir, ajoutait-il dans un post-scriptum, m’apparaît souvent comme une forme de bêtise. On a la tête lourde, on est pris de vertige, comme si le regard ne se portait pas en arrière pour s’enfoncer dans les couloirs du temps révolu, mais plongeait vers la terre du haut d’une de ces tours qui se perdent dans le ciel »
Entre le « souvenir » [die Erinnerung] [23] et cette « forme de bêtise » [eine Art von Dummheit], le lien ne peut se faire que par l’intermédiaire de Sebald lui-même : il faudrait parler plus exactement d’une « sorte de stupidité » ou une « sorte d’abrutissement » ; le mot Dummheit a une longue tradition philosophique, en concurrence avec Blödigkeit (bêtise) [24] : il ne s’agit pas d’un manque d’intelligence ou de savoir mais d’un état passif d’engourdissement des facultés, ici développé par la « tête lourde » et le « vertige » [schweren, schwindligen Kopf], littéralement la « tête lourde, étourdie »), qui nous fait aussi penser à Schwindel. Gefühle, texte antérieur de Sebald (1990).
Par ailleurs, s’il est clair qu’il ne s’agit pas de l’exploration d’un labyrinthe, toujours horizontal, aussi complexe et dangereux soit-il, mais d’un « vertige » vertical, intenable, la métaphore des « couloirs du temps » n’apparaît que dans la traduction française : en allemand, die Fluchten der Zeit n’est pas une expression toute faite ; elle signifie littéralement « les fuites du temps » et par extension dans cette formulation au pluriel, les « alignements » du temps, d’où la traduction par « couloir ». Sans que la référence proustienne soit explicite, on pourrait d’ailleurs voir ici davantage un écho de la dernière page du Temps retrouvé, où le narrateur écrit qu’il est « juché [au] sommet vertigineux [du temps qui « était « [s]a vie »] » [25] .
Dans Histoire, le rapport au temps passe par un autre paradigme mais qui s’oppose à celui de la surface d’abord associée à la carte postale, qui avait la capacité de couvrir comme des écailles et d’ouvrir comme des lucarnes : il s’agit du paradigme photographique mais distinct du topos de l’instantanéité [26] .
La carte postale, comme cette photographie « ratée », est-elle cependant à même de restituer l’épaisseur de l’expérience du temps que le récit traditionnel transforme en succession et en enchaînements ? A la fin du roman, le paradigme photographique, même « retouché » de cette façon, laisse place à la carte au sens propre.
La dernière occurrence de la carte est l’une de celles qui est la plus développée, comme au terme d’un processus d’invasion de l’espace textuel par le texte des cartes et par leurs images (textuelles si l’on y tient) entrechoquées, comme les cartes elles-mêmes, sorties de leurs paquets noués et jamais remises en ordre par les personnages auxquels elles étaient destinées puis par le narrateur qui ouvre la commode pour la vider.
Dans cette dernière séquence, on passe des premières cartes postales d’Henri à sa fiancée puis à sa femme, mère du narrateur, aux cartes de la mère à la grand-mère [27] . Ce qui motive ce passage semble rien moins que le courrier (une carte de condoléances ?) qui annonce la mort du père [28] . Cette « correspondance » paradoxale est la matrice même du roman : les cartes du fiancé auxquelles succèdent les cartes de celle-ci, une fois mariée, à sa propre mère constituent la structure même du court texte que Claude Simon publia dans Tel Quel en 1964 et dont nous avons rappelé qu’il le présenta ensuite comme la première version de ce qui deviendra le long roman. Le texte de 1964 rassemblait les cartes postales du père, qui deviendront la première séquence du roman, après l’incipit de l’acacia et « l’assemblée des ombres », et les cartes de la mère, qui seront placées à peine dix pages avant la fin du roman pour une période brève et la seule heureuse de la vie maternelle... et du roman [29] .
Dans la dernière séquence, l’accompagnement des cartes postales et leur développement sont plus que complets. On rencontre successivement la mention de la graphie (« son écriture », à propos de la mère donc [30] ), les timbres décrits comme des tableaux (le rose de la construction de style mauresque ; celui avec l’homme au casque...) et parallèlement, la carte « panoramique » de Barcelone, les textes de cartes postales beaucoup plus développés que dans la première séquence [31] , lus et avec leurs commentaires. L’ensemble est ressaisi dans une dernière phase dans laquelle pourtant la mère somnole, comme si le rêve lui-même était envahi par les cartes : le petit âne (trace de la carte « Caravan at rest » ?), le timbre, le titre « Félicité Island », les précisions sur la graphie, les indications de l’imprimeur et de publication, le texte de la carte opposé ici à la lettre... et pour boucler le tout, la scène d’écriture de la carte postale par la mère, avec la mention du narrateur à naître qui place ce « moi » en fin de phrase mais aussi en début de ligne de son livre imprimé :
[...] réfugiée dans la boutique d’un marchand quelconque sans doute celui qui lui avait vendu la carte postale un monsieur S. S. Ohashi à peau jaune regardant écrire sur un coin de table ou de comptoir la femme penchant son mystérieux buste de chair blanche enveloppé de dentelles ce sein qui déjà peut-être me portait dans son ténébreux tabernacle sorte de têtard gélatineux lové sur lui-même avec ses deux énormes yeux sa tête de ver à soie sa bouche sans dents son front cartilagineux d’insecte, moi ?... » [32] .
Le roman s’achève ainsi sur une scène qui, pour être ni parentale (le père pourtant est enfin censé être présent) ni explicitement sexuelle, n’en est pas moins une scène primitive : celle de la quasi conception, sous le regard d’un étranger, d’un moi écrivain par une femme qui écrivait... une carte postale.
Migration et médiation : éthique des cartes postales ?
Avec les cartes postales dans la fiction, quelque-chose nous est donné qui ne nous était pas destiné... mais qui aurait pu l’être. Aussi le cas de la carte diffère-t-il de celui de la lettre, fermée et personnelle, dont la publication convoque un voyeurisme absolu. La carte participe d’une familiarité et d’une circulation à laquelle nous sommes, au moins partiellement, intégrés.
Pour autant, les cartes ne nous sont pas données à lire comme des pièces d’un dossier auquel nous aurions accès, même sans effraction : toute mise en livre joue un rôle que l’insertion de la carte révèle. Et là réside peut-être ce qui permet de penser la carte de façon véritablement spécifique : en tant qu’outil de communication saisi dans le jeu littéraire et fictionnel, elle garde quelque chose de ce que l’on peut appeler « l’éthique médiatique », qui consiste pour un medium à être identifié comme tel.
Le risque peut cependant encore venir de ce qu’une carte dans un livre pourrait ne plus en être une. A moins que toute photo, voire tout livre (animé de l’éthique dont nous parlons), n’en devienne une, non plus pour les correspondants, non plus pour le narrateur mais pour le lecteur-spectateur du livre.
Peut-on pour autant établir une typologie qui mènerait à la carte postale offerte in fine au lecteur-spectateur du roman ? La carte peut être simplement mentionnée dans le texte, sous une forme nominale spécifique ou pronominale. Elle connaît un développement textuel lorsqu’elle est décrite, que son propre texte est cité de façon partielle ou qu’elle s’inscrit dans le récit au point qu’elle serait dite « narrativisée ». Elle trouve une équivalence de volume lorsque son texte est transcrit dans le texte romanesque mais cette équivalence recouvre un déplacement énonciatif et médiatique : son texte – le plus souvent manuscrit – apparaît sous forme typographique dans le livre. La carte peut enfin être reproduite en fac-similé ; cette reproduction « à l’identique » concerne en général la face « illustrée » – quoiqu’elle puisse elle-même comporter du texte –, mais également son autre face ne serait-ce par exemple que dans le cas d’Apollinaire que nous évoquions pour commencer.
La démarche typologique, pour réductrice qu’elle soit, révèle la nécessité d’articuler une approche énonciative et une approche médiatique ; elle nous amène à revenir sur la question de la reproduction, qui s’impose comme le cœur du problème.
Même dans le cas d’une reproduction, la question médiatique se pose ; sans parler de la face non illustrée des cartes, qui n’aura jamais l’aspect d’un cartonnage, la carte est rarement reproduite avec ses couleurs : le noir et blanc d’une image insérée dans un volume majoritairement textuel et imprimé en noir n’adoptera pas les mêmes valeurs que la carte d’origine, quand bien même elle était en noir et blanc. Les photographies qui « illustrent » les cartes au début du XXe siècle sont reproduites par phototypie et ne présentent pas l’aspect plus brillant des tirages photographiques.
Histoire ne reproduit pas d’images mais la couverture, dans la collection « Double » au moins, montre une dizaine de cartes postales anciennes juxtaposées. Cette couverture est reproduite sur le site de l’éditeur sur la page de présentation du livre :
http://www.leseditionsdeminuit.fr/livre-Histoire-2819-1-1-0-1.html
Cette photo n’est pas créditée, ni dans le volume, ni sur le site. Il s’agit pourtant d’une photo antérieure et qui n’a pas été réalisée pour la sortie du livre dans la collection « Double » en 2013.
On la trouvait déjà dans l’ouvrage de Lucien Dällenbach, dans lequel les crédits photographiques la classent dans la catégorie « Collection Claude Simon » [33] . La reproduction n’accompagnait pas une analyse d’Histoire... mais de Leçon de choses, sous prétexte que le processus de « pro-duction » de cette dernière est une « histoire exemplaire » et « généralisable » [34] . Une légende indique d’ailleurs « Les cartes postales d’Histoire. » qui présente implicitement comme absolue l’identification de ces documents au matériau du roman, sur la foi de la proximité que l’auteur a revendiquée avec Claude Simon dans son avant-propos. Ce texte précisait en outre : « Quant aux illustrations avec lesquelles mon texte dialogue parfois fort intimement, je les ai voulues le moins redondantes possibles et accordées d’abord aux inflexions de ma lecture » [35] .
En 2013-2014, certaines de ces cartes, ainsi que d’autres, étaient présentées à l’exposition « Claude Simon. L’inépuisable chaos du monde » au centre Pompidou. Aucune n’est reproduite, ni en groupe ni isolée, dans le dossier du Balises, le webmagazine de la BPI, qui n’est pas avare de documents :
http://balises.bpi.fr/claude-simon-la-construction-de-loeuvre-1
En revanche, on peut encore voir une photo de la vitrine en question sur le site de l’association Claude Simon, qui revient sur cette exposition :
http://associationclaudesimon.org/evenements-passes/expositions/article/exposition-claude-simon-a-la
Cette même vitrine avait donné lieu à une autre photo dans la notice que nous avons déjà évoquée, qui était en outre surtout accompagnée de la reproduction de trois de ces cartes :
http://associationclaudesimon.org/claude-simon/iconographie/article/les-cartes-postales-d-histoire
Ces reproductions font comprendre à quel point ces images ont une valeur pleine pour le texte, qui évoquait d’ailleurs par touches leurs couleurs, comme les effigies des timbres (le « roi couleur crevette », « l’éternel profil chauve et couronné vert olive » [36] ), les cartes mal colorisées (« firmament pervenche et rose tendu au-dessus de deux pyramides ocre le sol complètement rose au premier plan » [37] ), ou les inscriptions en couleurs.
Mais tout se passe comme si n’importe quelle reproduction, partielle, au format réduit et en noir et blanc pouvait suffire pour accompagner un texte... à l’origine duquel elles sont pourtant.
Dans le texte de Sebald, la carte postale de l’hôtel de Montreux reste ici l’exemple le plus riche. La mise en page du volume original allemand est très précise :
In Montreux, fuhr die Tante Fini fort, nachdem sie das Album aus einer ihrer Schlafzimmerschubladen hervorgeholt und//
vor mir aufgeschlagen hatte, ist der Ambros... [38]
A Montreux, poursuivit Tante Fini, après avoir rapporté l’album de l’un des tiroirs de sa chambre et//
l’avoir ouvert devant moi, Ambros a non seulement été... [je traduis ici littéralement et en respectant la répartition]
La mise en page peut donner l’impression de mimer l’expérience du personnage-narrateur et sa linéarité ; en réalité, il n’en est rien puisque notre appréhension d’une double page de livre ouvert ne suit pas nécessairement la succession linéaire du texte, surtout quand celui-ci est interrompu par une reproduction.
Ce n’est donc que rétrospectivement, et pour le seul narrateur, que cette image fonctionne comme une carte postale, au sens de la trace du passage dans un lieu donné.
Pour le lecteur-spectateur, elle pourrait se situer à un niveau quasi mythique : image nécessairement désuète et d’un temps révolu (quoique l’hôtel existe encore aujourd’hui) par sa forme identifiable de « carte postale ancienne » (noir et blanc aux traits précis de l’héliogravure, typographie et position de la légende) qui ne renvoie pas seulement à l’expérience d’Ambros mais à celle de ce « Welt von Gestern », de ce « monde d’hier » pour reprendre le mot de Stephan Zweig à propos du monde d’avant 1914.
Dans la version originale, l’image est plus grande que dans la traduction française, même dans le format pourtant grand de la collection d’Actes Sud : on lit clairement les lettres de l’enseigne en lettres capitales blanches sur le toit sombre du bâtiment : « HOTEL EDEN », à droite... et « EDEN HOTEL » à gauche ; car cette indication est bilingue et symétrique par rapport à l’axe central du bâtiment : seuls les stores irrégulièrement baissés conjurent le parallélisme ; et l’original dispose encore d’un détail qui soulignait cette symétrie : le drapeau suisse, qui a disparu dans la version française...
Le texte d’ailleurs opère un dernier glissement. L’original indique les noms d’hôtels majoritairement en italiques ; c’est le cas dans la phrase que nous avons déjà rencontrée : « Ich glaube jedenfalls, sagte Tante Fini, dass es das Eden war... » mais ils disparaissent de la traduction [« Il me semble en tout cas que c’était l’Eden, dit tante Fini... »], dans laquelle le mot « Eden » avec une majuscule mais en corps romain semble trouver pleinement son sens de paronomase, d’un âge d’or sans date et sans lieu déterminé, où tout drapeau serait de trop...
Dans Histoire ce décalage intrinsèquement lié à toute transposition pourrait être figuré par les mots, l’enseigne de bar mais surtout le titre de journal, « cités », « mentionnés », « reproduits » par le narrateur... et plus radicalement inversés encore que l’EDEN de Montreux [39] . Le titre de journal est ainsi renversé symétriquement par rapport à un axe horizontal pour mimer sa position par rapport au narrateur, transformé en lecteur de journal à l’intérieur de son récit et qui fait signe vers le lecteur du roman : mais il est ambivalent : la lecture n’est pas vraiment empêchée par la position inhabituelle du texte (il n’est même pas indispensable de retourner le livre, ce qui reste possible) ; la langue est familière (alors que le roman joue aussi par ailleurs avec des langues « étrangères », latin, espagnol, anglais...), la typographie est ici claire et complète (d’autres occurrences du titre étaient partielles)... mais le jeu se poursuit avec l’enseigne du bar, renversée par rapport à un axe vertical parce que le narrateur peut « distinguer par transparence les lettres » « sur le rabat de la toile » [40] . Dans tous les cas, ces inversions pourtant interfèrent avec la lecture du texte et révèlent l’emprunt médiatique.
Ces exemples nous montrent que le partage entre les cartes et les photographies n’a rien d’une évidence ; non seulement les photographies se mêlent aux cartes mais elles les devancent.
Dans Histoire, la première image mentionnée dans le texte et qui s’inscrit elle-même dans la relation parentale est « l’énorme agrandissement » qui rend présent le père sans que son statut même soit exprimé : « je pouvais maintenant le voir lui c’est-à-dire cet énorme agrandissement... » [41] .
Chez Sebald la première image qui apparaît, tirée d’un « album de photos » [42] de la mère du narrateur, représente la famille dans un appartement du Bronx et elle contient elle-même une image, donnée dans le texte pour une « huile » (Ölgemälde) représentant le Heimatsort, le village d’origine de la famille, W, situé en Allemagne : ce clocher typique du sud de l’Allemagne dans cet appartement des émigrants du Bronx marque donc un décalage et une imbrication des lieux, des espaces et des media figuratifs.
Mais est-il si facile de les distinguer des photos, non seulement de lieux mais de personnages ? La photo d’Ambros avec sa sœur, l’oncle Kasimir et la tante Fini sortira quant à elle de l’« un des albums posés sur la table », qui peuvent être les albums de la tante Fini elle-même [43] (le texte allemand parle aussi ici d’Alben, pluriel germanisé du mot latin encore utilisé au singulier). Quant au rare « cliché » (Abbildung) de Cosmo Solomon [44] , il se trouve ainsi dans un « album de cartes postales de l’oncle Adelwarth » Postkartenalbum) [45] . Ce « portrait photographique » de Cosmo en « costume arabe » est d’ailleurs curieusement recadré dans la version française ; le cadre a disparu, avec les indications qu’il portait : « Ch. Raad Photographer, Jerusalem Palestine » [46] . Il s’agirait pourtant donc d’un cliché du palestinien Khalil Raad (1854-1957 ; l’initiale du cadre renvoyant à la transcription du prénom en « Chalil »), qui avait un studio à Jérusalem avant la première guerre mondiale et qui fut le pionnier de la photographie au proche Orient [47] .
C’est encore une photo qui marque la fin de la première étape du récit... mais elle est envoyée au narrateur par l’oncle Kasimir, deux ans après leur rencontre où elle avait été prise d’une façon quasi subreptice. Elle fonctionne pour le narrateur comme un véritable adieu et un viatique pour sa propre vie, envoyée depuis ce « bord des ténèbres » (« Das Rand des Finsternis » [48] , pour reprendre le mot de l’oncle, qui l’accompagne de sa montre... Cette photo est d’ailleurs la plus petite du volume, très sombre (et l’on mentionnait l’heure tardive du cliché), en noir et blanc et d’un personnage vêtu de noir, à contre-jour. La version française, pour une fois, agrandit l’image et tente de l’éclaircir mais il reste que c’est autre chose qu’une simple photo : une trace du destinataire lui-même, comme venue du passé et comme de l’au-delà.
Il semble que ces objets actualisent pour le lecteur-spectateur de ces fictions le modèle de l’envoi découvert et semblent l’étendre à toute communication, entre les personnages, entre le narrateur et son passé, et entre le lecteur et la fiction elle-même.
Ce phénomène n’est pas propre à Sebald. Le texte littéraire adopte largement comme paradigme le modèle communicationnel de l’envoi, en jouant avec l’idée même d’une communication, quitte à la contredire.
Je ne prendrai qu’un seul et dernier exemple ici : le Petit livre des Migrations, que Pedro Kadivar, de nationalité iranienne, a publié directement en français en 2015 [49] . Ce n’est pas tant ce titre, pourtant évocateur pour toutes les études réunies ici (nous finirons bien par reconnaître que cette migration des genres littéraires et artistiques est aussi travaillée par la question de la migration des personnes), qui me le fait retenir que le souvenir d’un feuilletage rapide : celui d’un texte émaillé d’images. Elles sont en réalité peu nombreuses, en noir et blanc, de petite taille et assez anodines en apparence...
Le texte même semble les ignorer : « Abolition des frontières » est un texte dont, nous dit la notice qui accompagne ce titre, la « première version a été écrite pour la lecture-performance, portant le même titre, créée le 2 mai 2012 aux Ateliers Berthier à Paris » [50] . Je n’ai pas assisté à cette lecture mais en tant que telle, il y a toutes les chances pour qu’elle n’ait pas été accompagnée d’images. Après le titre de la première séquence, « Schlachtensee » – il s’agit d’un lac célèbre près de Berlin mais c’est aussi un mot qui sonne et qui claque (die Schlacht c’est la « bataille », le « combat »), comme s’il appelait le premier mot du texte : « Ecoutez » [51] – le texte finit par liquider ironiquement l’image attendue : une phrase semble encore l’annoncer, « Voici Schlachtensee, un lac près de Berlin », mais rien ne vient avant la page suivante (à moins que ce ne soit une erreur de mise en page mais ce volume de la collection « Le sentiment géographique », chez Gallimard donc, est plutôt soigné).
Et l’image qui arrive est l’une de celles que l’éditeur crédite à la fin à l’auteur lui-même. Et l’on sent bien que l’intérêt n’est pas là, mais dans le texte puissant qui l’accompagne : « A force de nager dans ses eaux, je devins natif de ce lac... »
Alors que de cette image, une vue du lac miroitant au crépuscule, on pourrait dire qu’elle est une vraie carte postale, le texte est une expérience qui, malgré la communauté des « semblables » voire leur similitude de « pareils », se laisse deviner comme celle, « indicible », d’un nageur « étranger » [52] .
On assiste à une « cartepostalisation » généralisée qui a ceci de positif (car elle est chez Derrida, aussi négative) qu’elle est une position éthique : le texte s’y révèle dans sa matérialité complexe, textuelle et visuelle à la fois, celle d’un envoi public, à découvert, dont le destinataire est potentiellement tout autre que celui auquel il est explicitement adressé...
Si la carte postale ne peut que s’inscrire dans des déplacements, elle le fait moins à la façon d’une migration, repérable, orientée dans l’espace, régulière, qu’à la façon d’une dissémination dont le trajet importe moins que ses termes, et démultipliée.
Dans la fiction narrative elle pourrait, au-delà de l’intérêt qu’elle présente pour les personnages qui la reçoivent et la conservent, interférer avec la construction du récit par le narrateur mais comme autant de chocs qui font se mêler le récit plus qu’ils ne le structurent.
Pour le lecteur-spectateur des livres où elle apparaît, texte et/ou image, elle ouvrirait la voie à une fiction lucide quant à ses supports, au point de pouvoir caractériser ce qui, au départ, n’était pas une carte au sens postal du terme.
Tout risque-t-il de devenir « carte postale » ? J’en veux de fait, comme contre-exemple Sébastien Lapaque qui, dans sa Théorie de la carte postale, parodie une strophe d’un poème de William Blake, en créant un texte qui pourrait s’appeler « The postcard » et non plus « The Smile » :
There is a Postcard of Love
And there is a Postcard of Deceit
And there is a Postcard of Postcards
In which these two Postcards meet.
D’après William Blake [53] .
La pointe de l’essayiste nous servira d’antidote contre cette tentation : « carte postale » ne peut devenir une expression vicaire quasi universelle qu’au prix d’une mise à distance ironique. Tout n’est pas carte postale mais elle ne saurait être ce rien auquel la condamne l’usage.
Bibliographie
Badr al-Hajj, « Khalil Raad. Jerusalem Photographer », Journal of Palestine Studies, Washington, n°12-11, 2001 ; article en ligne http://www.palestine-studies.org/jq/fulltext/78083.
Barthes, Roland, « Rhétorique de l’image » in L’Obvie et l’obtus, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points », 1982.
Dällenbach, Lucien, Claude Simon, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Les contemporains », 1988.
Derrida, Jacques, La Carte postale de Socrate à Freud et au-delà, Paris, Flammarion, 1980.
Kadivar, Pedro, Petit livre des Migrations, Paris, Gallimard, coll. « Le sentiment géographique », 2015.
Lapaque, Sébastien, Théorie de la carte postale, Arles, Actes sud, 2014.
Proulx, Edna Annie, Postcards, New-York, Colliers Books, 1993 ; Cartes postales, trad. française d’Anne Damour, Paris, Payot et Rivages, 1999.
Proust, Marcel, « Le Temps retrouvé », Paris, Gallimard, coll. « Folio Classique », 1989.
Ripert, Aline et Frère, Claude, La Carte postale, son histoire, sa fonction sociale, Paris, Presses universitaires de Lyon/ Éditions Du CNRS, 1983.
Ronell, Avital, Stupidity, University of Illinois Press, 2001 ; Stupidity, trad. française Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points », 2006.
Sebald, W. G., « Ambros Adelwarth » in Die Ausgewanderten, Frankfurt am Main, Eichborn AG, 1992 ; les citations allemandes renvoient à la réédition Fischer, 1994, 215. Sebald, W. G., « Ambros Adelwarth », in Les Emigrants, traduction française de Patrick Charbonneau, Actes Sud, 1999, p. 81-174.
Simon, Claude, Histoire, Éditions de minuit, 1967 ; les citations renvoient à la réédition dans la collection « Double », 2013.
Notes
- [1]
Aline Ripert, et Claude Frère, La Carte postale, son histoire, sa fonction sociale, Presses universitaires de Lyon/Éditions du CNRS, 1983, notamment p. 17-40.
- [2]
Claude Simon, Histoire, Éditions de minuit, 1967 ; les citations renverront à la réédition dans la collection « Double », Minuit, 2013.
- [3]
Winfried Georg Sebald, W. G., « Ambros Adelwarth » in Die Ausgewanderten, Frankfurt am Main, Eichborn AG, 1992 ; les citations allemandes renverront à la réédition Fischer, 1994, p. 95-215 (désormais abrégé en F). Les citations françaises renverront, sauf mention contraire à « Ambros Adelwarth », in Les Emigrants, traduction française de Patrick Charbonneau, Actes Sud, 1999, p. 81-174 (désormais abrégé en A).
- [4]
Jacques Derrida, La Carte postale de Socrate à Freud et au-delà, Flammarion, 1980.
- [5]
Claude Simon, op. cit., p. 13.
- [6]
Ibid., p. 16.
- [7]
Ibid., p. 19-20.
- [8]
Winfried Georg, Sebald, F, p. 113/ A, p. 95.
- [9]
Roland Barthes, « Rhétorique de l’image » in L’Obvie et l’obtus, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points », 1982, p. 36.
- [10]
Winfried Georg Sebald, A, p. 140, 142, 174, 175.
- [11]
Winfried Georg Sebald, F, p. 95.
- [12]
Winfried Georg, Sebald, F, p. 140 / A, p. 116.
- [13]
Claude Simon, op. cit., p. 110.
- [14]
Ibid., p. 258.
- [15]
Ibid., p 265.
- [16]
Ibid., p. 82.
- [17]
Ibid., p. 265.
- [18]
Ibid., p 21.
- [19]
Edna Annie Proulx, Postcards, New-York, Colliers Books, 1993 ; Edna Annie Proulx, Cartes postales, trad. française d’Anne Damour, Payot et Rivages, 1999.
- [20]
Winfried Georg Sebald, A., p. 95 / F, p. 113.
- [21]
Ibid., A, p. 152 / F, p. 186.
- [22]
Ibid., A, p. 114 / F, p. 138.
- [23]
Ibid., A, p. 173 / F, p. 215.
- [24]
Sur ces notions, voir Avital Ronell, Stupidity, University of Illinois Press, 2001 ; Avital Ronell, Stupidity, trad. française Éditions du Seuil, coll. « Points », 2006.
- [25]
Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Paris, Folio Classique, p. 352.
- [26]
Claude Simon, op. cit., p. 284.
- [27]
Ibid., p. 409.
- [28]
Ibid., p. 408.
- [29]
« Puis ce fut elle qui les envoya », ibid., p. 409.
- [30]
Ibid., p. 413.
- [31]
Ibid., p. 420, 22-23.
- [32]
Ibid., p. 423-424.
- [33]
Lucien Dällenbach, Claude Simon, Éditions du Seuil ; coll. « Les contemporains », 1988, p. 218.
- [34]
Ibid., p. 106.
- [35]
Ibid., p. 6.
- [36]
Claude Simon, op. cit., p. 211, 423.
- [37]
Ibid., p. 35.
- [38]
Sebald, A, p. 113.
- [39]
Ibid., p. 352, 353, 356.
- [40]
Ibid., p. 253.
- [41]
Claude Simon, op. cit., p. 18.
- [42]
Winfried Georg Sebald, A, p. 88 ; F, p. 104.
- [43]
Ibid., A. p. 121/ F, p. 146.
- [44]
Ibid., p. 111/134.
- [45]
Idem.
- [46]
Ibid., A, p. 114/F, p. 137.
- [47]
Voir Badr al-Hajj, « Khalil Raad. Jerusalem Photographer », Journal of Palestine Studies, n°12-11, 2001, p. 34 ; l’article est consacré à ce photographe et ne comporte naturellement aucun renvoi à notre récit : article en ligne http://www.palestine-studies.org/jq/fulltext/78083
- [48]
Sebald, A. p. 108/F, p. 129.
- [49]
Pedro Kadivar, Petit livre des Migrations, Gallimard, coll. « Le sentiment géographique », 2015.
- [50]
Ibid., p. 97.
- [51]
Ibid., p. 99.
- [52]
Ibid., p. 101.
- [53]
Sébastien Lapaque, Théorie de la carte postale, Le Méjean, Actes sud, 2014, p. 55.
Pour citer cet article
Benoît Tane,, "La carte postale dans la fiction narrative (Simon, Sebald). Un écrit migrateur ?", SFLGC, Bibliothèque comparatiste, publié le 01/07/2019., URL : https://sflgc.org/acte/tane-benoit-la-carte-postale-dans-la-fiction-narrative-simon-sebald-un-ecrit-migrateur/, page consultée le 05 Juillet 2025.
Biographie de l'auteur
TANE Benoît
Ancien élève de l’ENS de Fontenay/Saint-Cloud, agrégé de lettres modernes, il est l’auteur d’une thèse sur l’illustration du roman au XVIIIe siècle. Il mène des recherches sur la fiction romanesque et sur ses interactions avec ses supports matériels (texte et image, histoire du livre, imaginaire du livre et de l’impression, bibliophilie et biblioclasme phénomènes de transpositions, intermédialité…).
Il est l’auteur de : « Avec figures… ». Roman et illustration au XVIIIe siècle, P.U.R. coll. « Interférences », 2014, 562 pages, 100 reproductions. Il a également publié une réédition de Clarissa dans la traduction de Prévost, avec de nombreuses reproductions (Lettres angloises ; ou Histoire de Miss Clarisse Harlove [Clarissa, or the History of a young Lady, Richardson (1747-1748)] ; traduction d’Antoine Prévost d’Exiles (1751). Textes choisis et établis par Benoît Tane, introduction et notes de Stéphane Lojkine, choix d’illustrations du XVIIIe siècle, Presses universitaires de l’université Laval, Québec, 2007, 641 p.). Son activité de recherche est mise à jour sur le site Academia : http://univ-tlse2.academia.edu/Beno%C3%AEtTane. Voir par exemple : « Dead Letters : une naissance du roman américain (1769-1853) ? ». Communication au congrès SFLGC, Université d’Amiens, 2015. Publication dans les actes du congrès : Nouveaux mondes, nouveaux romans, Actes édités par Louise Dehondt, Anne Duprat, Irène Gayraud, Catherine Grall et Christian Michel, in Bibliothèque comparatiste, en ligne : http://sflgc.org/acte/benoit-tane-dead-letters-une-naissance-du-roman-americain-1769-1853/